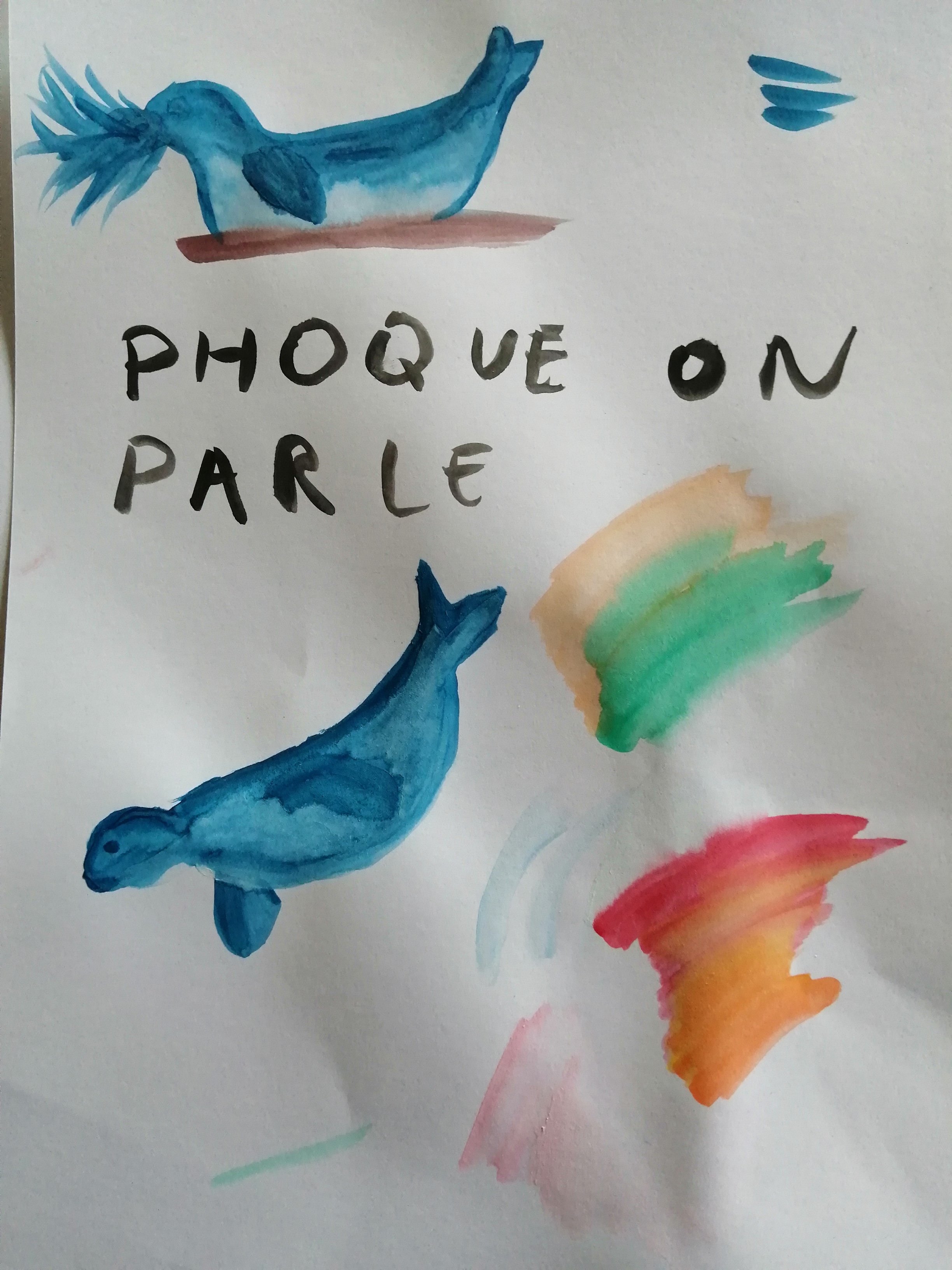Chirurgie, religion, bêtise et petits instants de grâce… Le journal d’un type qui a eu la bonne idée d’avoir une appendicite pendant l’épidémie de coronavirus, au Brésil.
. Pilules d'hôpital - 1
L'infirmière vient me faire une prise de sang.
- Je suis du labo.
Vous pensez : laboratoire, lieu technique, d'analyse et de science.
- Vous n'allumez pas le téléviseur, non ? Vous faites bien. Ils ne passent que des choses qui tentent d’ébranler notre foi. Et plus encore maintenant, avec ce machin qu'ils ont inventé juste pour nous faire peur.
En deux minutes, elle m’a fait une prise de sang, a prononcé le nom de Jésus onze fois, et est repartie.
Au laboratoire.
. Pilules d'hôpital - 2
Dopé, le patient a zappé cette pilule.
. Pilules d'hôpital - 3
Aux urgences, un médecin et trois ou quatre infirmières. Ils parlent de l'aide de 600 réaux accordée pendant la quarantaine. Le médecin étonné :
- Seulement pour ceux qui gagnent jusqu'à 28 000 par an. Les gars, qui survit avec 28 000 par an?
Silence des infirmières.
. Pilules d'hôpital - 4
Toujours le médecin et les infirmières. Quarantaine.
L'une des infirmières :
- Je ne sais pas ce qui est pire. Restez à la maison, comment ? Mon mari dit que le monde doit continuer à fonctionner, et qu’il y en a bien qui vont survivre. Il travaille en indépendant.
J'attends le docteur. Il dit :
- Je ne sais pas s'il a tort.
Un docteur.
. Pilules de l'hôpital - 5
Sur le chemin du retour, un chauffeur Uber :
- Hier, trois petits vieux que je connais sont morts. Aucun du corona. Je suis sûr qu’ils vont les mettre dans les statistiques.
Je reste silencieux, puis je réponds.
- J'ai des amis en Italie, en France. Croyez-moi, c'est grave et ça va empirer.
Il me regarde dans le rétroviseur. Son regard me dit clairement: "t’es dingue".
. Pilules d'hôpital - 6
Un autre chauffeur Uber :
- J’ai travaillé dans les prothèses et le matériel chirurgical. Le médecin reçoit une commission pour chaque pièce, tout est surfacturé. Il y en avait un qui prenait 500 000 par mois, rien qu’avec mon laboratoire. Personne n’osait le défier, parce que s’il ne pouvait pas vous encadrer, il vous faisait virer.
. Pilules d'hôpital - 7
Le jour J du débarquement en Normandie, beaucoup sont morts pour libérer le monde, tandis que des gamins jouaient au ballon sur un terrain vague au Brésil.
Je viens de sortir d'une intervention chirurgicale. Je parle à l'infirmière, originaire du Sergipe, sérieuse mais sympathique, qui m'emmène dans ma chambre :
- Vous aller avoir au moins deux mois difficiles.
- C'est tout ?
Je trouve les prévisions basses, mais je ne dis rien.
Elle ajoute :
- Ce sera difficile pour ceux qui vont survivre.
- Avez-vous des amies contaminées?
- Plusieurs. Certaines en soins intensifs, d'autres ont été testées positif et sont en quarantaine. Beaucoup de médecins aussi. L'hôpital embauche dans le cadre d’un plan d’urgence.
Je pense aux nombreuses personnes encore aliénées qui n’ont pas compris ce qui est en train de se passer.
Le jour J de l'invasion de la Normandie, beaucoup sont morts pour libérer le monde, tandis que des gamins jouaient au ballon sur un terrain vague au Brésil.
Nous n'avons pas le droit d'être ces gamins.
. Pilules d'hôpital - 8
Le premier jour où vous vous rendez dans votre chambre, on vous autorise à porter votre T-shirt à l’effigie de Guernica et un short, après tout l'élégance compte.
Le deuxième, on ouvre votre tablier à l'arrière, vous en faites un charmant kimono.
Le troisième, tout le monde voit votre cul et vous vous en foutez.
. Pilules d'hôpital - 9
Le confinement et l’urgence causée par mon appendice m’ont saisi durant la meilleure phase physique de ma vie.
15% de masse graisseuse, la "tablette de chocolat" si socialement idolâtrée bien en place, comptant rester visible, même s’il ne s’agit pas d’un objectif ni d’un but en soi. Après tout, je ne dis ne pas non à une friandise après le déjeuner, ni à une bière ou du vin, au moins deux fois par mois.
Mais n'étant pas grand ni tout à fait crétin, pas assez fortuné pour m’offrir des Ferrari ou des restaurants, n’exerçant pas une profession aventureuse telle que surfeur ou parachutiste, et sachant que l'intelligence n'est pas exactement un élément de valeur aujourd'hui, un homme de 52 ans a besoin d'une attrait sexy pour rester sur le marché.
C’est avec un sentiment de propriétaire que je vois dans le miroir la possibilité que ma tablette de chocolat soit gommée, même si j’essaye de ne pas y accorder trop d’importance.
- "Si ça te dit, je pars deux semaines et je te récupère, cher abdomen."
Puis un coronavirus fait son apparition, un confinement, et une appendicite.
Une semaine, vous montez 500 marches pour vous échauffer avant la salle de sport, la suivante vous allez par le monde comme un scaphandrier ivre qui va accoucher de trois ananas.
Le ventre énorme, rond et déformé, avec plusieurs marques d'incision qui laisseront des cicatrices.
Mon abdomen ...
Rien n'est à nous. Ni la Ferrari ni les tablettes de chocolat.
Nous sommes juste un tas de molécules qu'on a refourguées.
. Pilules d'hôpital - 10
Alors que je me trouvais à bord d’un Uber pour la deuxième fois, souffrant déjà d’une appendicite aiguë, je me suis allongé sur le siège arrière de la voiture en levant les yeux.
Un après-midi glorieux, comme chaque jour depuis la quarantaine. Au-dessus, dans le ciel sans nuages, un minuscule vautour tournoyait.
Bien sûr, j'ai pensé à un dessin animé. Je lui ai dit :
- Je suis toujours vivant, le jeune vautour maladroit devient une charogne.
Dans le sud de São Paulo, cela fait trois semaines qu'il fait beau. Des maritacas matinales sillonnent le quartier. Le barrage de Guarapiranga doit être plein de hérons, canards et poulets d'Angola. Mes plantes dans l'arrière-cour poussent, les fougères ressemblent aux bimbos musclées de la salle de sport.
Ici à Jabaquara, où se trouve l'hôpital, le bruit des avions résonne quatre ou cinq fois par jour. La moyenne était d'un avion toutes les deux minutes.
J'écoute les oiseaux, qui auparavant fuyaient le quartier à cause des turbines, circulant dans la région.
La nature reste exubérante.
Un air plus pur, un ciel avec plus d'étoiles, des animaux plus paisibles, c'est presque un témoignage de mépris envers l'espèce humaine.
La nature ne dépend pas de nous. La nature n'a pas besoin de nous. Je dirais même que nous faisons déjà des heures supplémentaires.
Elle a envoyé un message évident :
- Vous n'êtes qu'une espèce comme une autre. Comme des milliers qui ont déjà existé et se sont répandues sur le globe. Vous êtes arrogants, ignorants, destructeurs et limités. Je vous élimine avec un virus créé en un claquement de doigt. Comprenez votre lieu de vie, respectez votre maison, révisez vos concepts.
Il est certain que nous n'apprendrons pas.
Nous sommes les vautours.
Et le vautour maladroit devient charogne.
. Pilules d'hôpital - 11
Trump et les États-Unis ont siphonné le marché mondial des équipements de lutte contre les coronavirus. Ils sont allés en Chine, ont fait l’offre la plus élevée, nettoyé le stock (y compris la commande à destination du Brésil, qui se retrouve le bec dans l’eau).
Mais ils ont payé aussi très cher pour le prendre à d'autres pays, y compris l'Allemagne.
Ils ont retiré le stock du monde.
C'était le gouvernement américain.
Pour le distribuer aux hôpitaux, pas vrai ?
Non.
Il existe six ou sept grandes sociétés de fournitures médicales aux États-Unis. Ils possèdent des camions et un système de distribution.
Le gouvernement va transmettre tout ce matériel confisqué au monde (l'Allemagne a taxé cela de piraterie moderne) à ces entreprises qui vont le VENDRE aux hôpitaux.
Je vais répéter : VENDRE.
Aux enchères, comme eBay.
L’hôpital qui offre le plus emporte la mise.
Et puis il adresse la note aux patients.
Les hôpitaux qui n'ont pas de fric n'ont pas de masque.
Le patient qui n'a pas de fric ne respire pas.
C'est du pur capitalisme, sans censure ni hypocrisie.
L'État injecte des millions et cède un marché monopolisé à des partenaires privés, de bonne grâce.
Il prend tout au monde entier et fait d’un atout vital un profit astronomique pour les géants du secteur, sans rien en retour.
Dans la pilule 10, j'ai dit que nous n'apprendrions pas.
Cela n'a pas pris trois minutes.
Ci-dessous le lien vers la conférence de presse du gouvernement américain expliquant tout cela comme si de rien n’était :