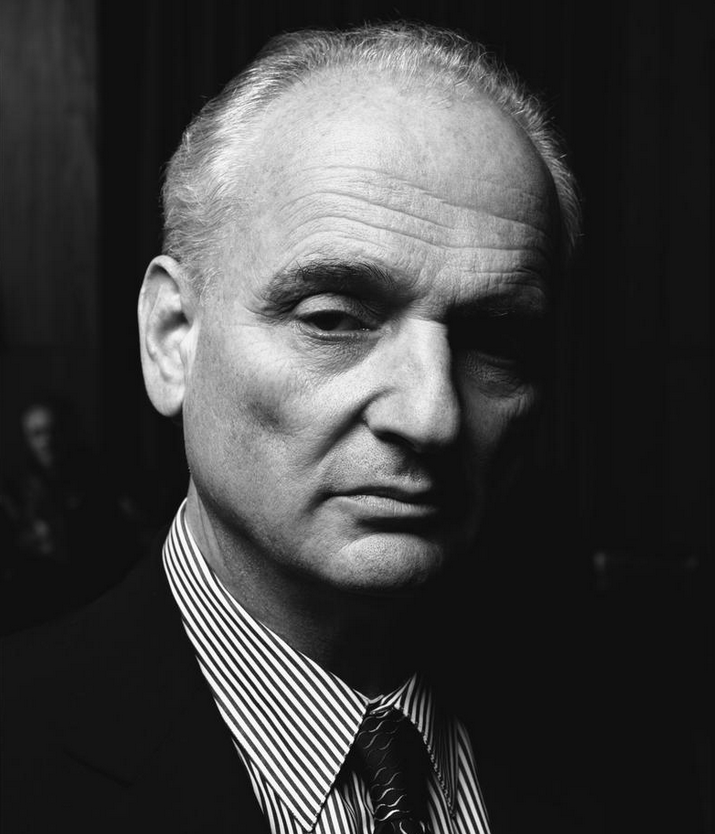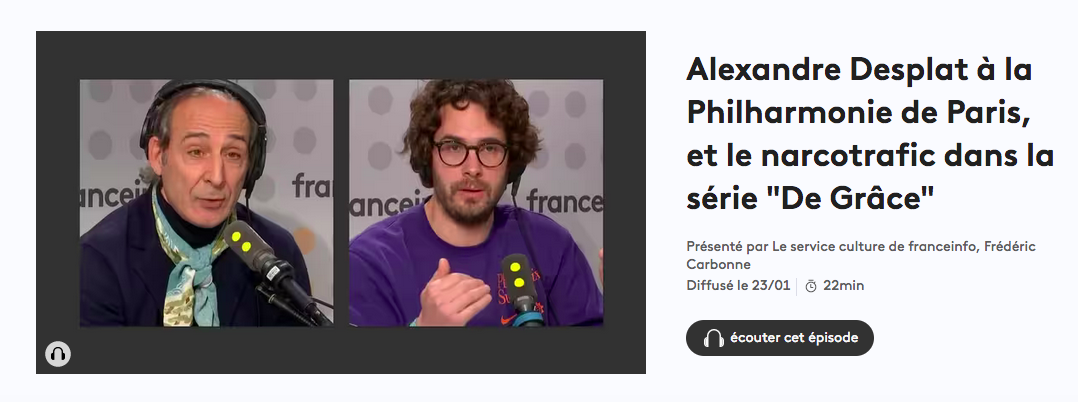A travers la Manche
Les artistes ont-ils encore un rôle ?
Lors des rencontres autour de mon deuxième roman, Un coup de pied dans la poussière, on me demande très souvent si l'art et les artistes peuvent rendre le monde moins barbare. A chaque fois, je demande à lire un passage bien précis de mon livre. Le voici :
Le contexte : 1989. Première Intifada. Poète palestinien, Hussein s'adresse à Nissan, le héros du roman, peintre juif venu en Cisjordanie donner des cours de dessin aux enfants du camp de réfugiés de Jénine :
Nissan, je te connais seulement par ce que Dorit m’a dit de toi. Je te remercie d’être parmi nous. Nous avons besoin des artistes pour fouiller les sentiments qui nous soulèvent. Nous, les Palestiniens, sommes de fiers guerriers, mais aussi les jouets de promoteurs de bonne conscience, d’intérêts obscurs et cyniques, le support de haines en tous genres, le prétexte à des combats qui ne sont pas les nôtres… et des victimes. Nos parents ont découvert leur patrie en la perdant. Auparavant, leur existence, c’était la coutume, le village, le myrte, l’olivier, les troupeaux, les champs, les nuits d’été sur les toits des maisons. Je souhaite la paix pour nous et nos enfants, mais dans la décence et la justice. Or, il faut apprendre à nos enfants à souhaiter ces choses-là. Qu’il soit théâtre, littérature, peinture, musique, l’art peut exprimer notre soif de vivre, l’insoutenable nostalgie de notre terre, notre combat pour la recouvrer, avec le désir de ne pas ajouter d’injustice à l’injustice, de cruauté à la cruauté. Je veux enseigner à ces enfants l’insoutenable joie d’être au monde et ce que la paix nécessite de courage. Les artistes ne rendront pas l’humanité meilleure, mais peut-être plus consciente de la nécessité d’échapper à l’insignifiance et à la barbarie.
“Je veux enseigner à ces enfants l’insoutenable joie d’être au monde et ce que la paix nécessite de courage. Les artistes ne rendront pas l’humanité meilleure, mais peut-être plus consciente de la nécessité d’échapper à l’insignifiance et à la barbarie”
Photo : Hosny Salah @hosnysalah, photographe vivant actuellement dans la bande de Gaza, via Pixabay.
Une bien étrange écriture
Dans un exemplaire d’occasion acquis voici quelques années de Riens philosophiques, un livre de Kierkegaard, je découvre une feuille pliée en quatre, au grain fragile, très fine, couverte de mots illisibles. Sur la gauche, une date qui pourrait être 1961. L’écriture est disposée sous forme d’une colonne qui se tord en diagonale, de la droite vers la gauche.
Mes hommages anticipés à qui saura déchiffrer ces pattes de mouches et ces vaguelettes.
Mon Brésil
Mon Brésil, tu es le plus beau des cauchemars, le plus affreux des rêves.
On te cherche sous les clichés, qu'on retrouve pourtant comme des épiphanies : la vue sur la baie de Guanabara depuis le Christ rédempteur, une promenade un dimanche matin à Copacabana ou dans la jungle de la Costa verde, une partie de foot avec un ami qu'on a pas vu depuis près de sept ans.
Mais tu existes aussi très loin des lieux communs : les numéros des vendeurs aux feux rouges qui dégainent leur terminal carte bancaire pour vendre leur camelote, les skylines de l'immense São Paulo et les villages uniquement peuplés d'une pompe à essence.
Tu es le pays de l'alliance des contraires, de l'opulence et de la misère, de la technologie de pointe et des carrioles moyenâgeuse, du rigorisme religieux et de la liberté sexuelle.
Parfois, je voudrais te haïr, car tu es injuste, stupide et cruel. Il faut dire que tu subis aussi le poids de l'Histoire et de l'une des pires classes politiques du monde, sans oublier les évangélistes millionnaires qui braillent à la télévision en offrant l'absolution des péchés en échange d'un généreux versement Paypal.
La plupart du temps, tu en ris, dans un mélange de fatalisme et de superbe. Le rire est l'arme de l'impuissance, sinon du désespoir. Tu ris pour ne pas pleurer. Après tout, tu es le pays de la tristesse enchantée et de la "saudade", cette nostalgie pour tout ce qui ne s'est jamais produit, doux vertige. Mais cela, tu ne le confies qu'à ceux qui prennent le temps de t'écouter.
Mon Brésil, cela fait trente ans que tu me fascines. A l'époque, les gens te résumait en trois mots : misère, carnaval et football. Aux yeux de beaucoup, j'étais un peu idiot et naïf, comme tous les gosses, et cela passerait avec le temps. Mais cela ne s'est jamais tari. Aujourd'hui, les bureaucrates de la culture ont même lancé une année France-Brésil. C'est dire si tu es devenu "cool".
C'est grâce à toi que j'ai commencé à écrire et mon premier roman se déroule en partie chez toi, à Salvador da Bahia.
Si la passion permettait de produire des lingots d'or, tu serais sans doute le pays le plus riche du monde. Même si tes élites, ton crime organisé et les affairistes du monde entier trouveraient sans doute un moyen pour siphonner ta richesse en proportions industrielles.
Tu n'es pas un pays pour les amateurs, comme disait Tom Jobim. Je crois que tu es un pays pour les rêveurs mais pas pour les naïfs.
Mon Brésil, prends soin de toi, de tes enfants et de ta terre, car tu es précieux pour le monde entier.
Até breve. A bientôt.
Brésil, le bâtisseur de ruines , Eliane Brum
Eliane Brum revient sur les années 2000 à 2020 au sein de ce pays-continent qui attend désespérément le futur.
Mes amis brésiliens m'avaient fait part de leur sentiment d'avoir traversé un cauchemar, entre l'aveuglement et les trahisons de la gauche de Lula, Rousseff, puis la nullité de Temer et enfin le règne de la bêtise, du cynisme et de l'horreur sous l'extrême-droite de Bolsonaro (dont l'un des héros est l'un des pires tortionnaires de la dictature militaire), mais ce livre montre que cela a été encore pire que ce que je croyais.
Pour le Brésil, ces années ont été une dystopie bien réelle, ce qui peut arriver de pire à la démocratie. Lorsque la tentation de la vérité et les mots n'importent plus, que tout se vaut et qu'on a renoncé à tout courage. A commencer par le courage intellectuel. Un avertissement et un livre magistral.
Eté sicilien
Nous parlâmes de la Sicile éternelle, celle des choses de la nature; du parfum du romarin sur les Nébrodes, du goût de miel de Melilli, de l'ondoiement des moissons en une journée de vent en mai telles qu'on les voit depuis Enna, des solitudes autour de Syracuse, des rafales de parfum déversées sur Palerme, dit-on, par les plantations d'agrumes lors de certains couchants de juin. Nous parlâmes de l'enchantement de certaines nuits d'été devant le golfe de Castellamare, quand les étoiles se reflètent dans la mer qui dort et que l'esprit de celui qui est couché à la renverse au milieu des lentisques se perd dans le gouffre du ciel, alors que son corps, tendu et aux aguets, craint l'approche des démons.
La mer a la couleur des paons; et juste en face, au-delà des vagues changeantes, se dresse l'Etna; d'aucun autre endroit il n'est aussi beau que de là, calme, puissant vraiment divin. C'est un de ces lieux où l'on voit l'un des aspects éternels de cette île qui a tourné si bêtement le dos à sa vocation, celle de servir de pâturage pour les troupeaux du soleil.
“C’est un de ces lieux où l’on voit l’un des aspects éternels de cette île qui a tourné si bêtement le dos à sa vocation, celle de servir de pâturage pour les troupeaux du soleil”
Ces deux extraits sont tirés de la nouvelle Le professeur et la sirène, de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, traduite par Jean-Paul Maganaro.
Dans "Le 1 Hebdo" pour évoquer le trafic de drogue au Havre
J’ai eu le privilège d’écrire l’édito du numéro du 1 Hebdo du 18 juin, où j’évoque le trafic de la drogue dans ma ville natale et la toute-puissance de la poudre blanche. En voici le texte complet :
La cocaïne est la putain la plus respectée de la planète. Ces derniers mois, j’ai voyagé à Iquitos, la capitale de l’Amazonie péruvienne, aux Antilles, et suis souvent rentré au Havre, ma ville natale. Partout, on m'a parlé d’elle. A Iquitos, elle a ramené des milices et des rêves de richesse fulgurante dans une ville frappée par une misère noire. Aux Antilles, elle est cinq fois moins chère qu’en Europe et a permis à certains pêcheurs d’un paradis fiscal comme Anguilla de créer des banques. Elle a fait entrer Le Havre dans une nouvelle ère en semant l’angoisse et le silence sur le port. Désormais, la Porte océane accueille même des émissaires des plus gros cartels du monde, paraît-il.
La cocaïne est une séductrice doublée d’une magicienne. Elle peut changer des vies : au Havre, cela rapporterait environ 60.000 euros de sortir d’un conteneur un sac rempli de poudre. Soit quinze minutes de boulot. Au taux horaire, c’est mieux que le salaire d’un footballeur évoluant en Arabie Saoudite. Le seul problème, c’est qu’on finit par vous rappeler au milieu de la nuit pour extraire d’autres sacs et que, si vous refusez, la voix au bout du fil se met à vous parler de votre femme et de vos enfants.
La cocaïne n'est plus seulement la drogue des riches. Boulangers, pêcheurs et employés de bureau la consomment. Il faut dire qu’elle éteint la fatigue, l’ivresse et qu’elle aide à tenir la cadence : vous dormez trop, ne travaillez pas assez, ne marchez pas assez vite dans l'open-space. Oui, nous sommes tous insuffisants par les temps qui courent.
Avec Maxime Crupaux, j’ai créé et écrit la série De grâce, qui relate l’histoire d’une famille de dockers havrais qui explose à cause du trafic de cocaïne sur le port. Dans le contexte actuel de la télévision française, créer une série est un très long combat et, durant les huit années qu'a duré le développement de De grâce, la donne au Havre a totalement changé. En pire. La faute à la blanche. Et force est de constater que nous avons été rattrapés par la réalité. Il y a eu les saisies croissantes et malheureusement l’assassinat d’un docker en 2020. Quand on ne lui obéit pas, la cocaïne vous supprime. Pour exercer la terreur, toutes les barbaries sont bonnes : exécution sommaire, décapitation, tabassage, attentat...
Le port a toujours été un lieu de trafics. Au Havre, nombreux sont ceux qui ont récupéré un polo ou des baskets de marque tombées du camion, refourgués par un copain ou un cousin. Moi compris. C’est la justice du pauvre, qui prend sa dîme sur les biens défilant sous ses yeux. On se casse la santé à les décharger, les conditionner et les transporter : pourquoi ne pas se servir ? Sur les quais, la tradition de la grapille veut qu’on tape dans les conteneurs à haute valeur ajoutée : champagne, parfums, consoles de jeu, etc. Les transporteurs et les armateurs le savent. On vous dira aussi que certains douaniers ne sont pas les derniers à ce jeu-là. C’est la loi des ports, avec les codes des familles qui le font vivre : pilotes, lamaneurs, pêcheurs, flics, marins, etc. L’oncle de ma mère était docker. Chaque Noël, il rentrait avec une enveloppe pleine de billets, qu’on appelait « la tarte à la crème ». De quoi faire plaisir à la famille. Personne ne posait de questions. C’était un geste de la communauté envers les siens, la marque de sa solidarité – ce qui est tout sauf un vain mot.
L'assassinat de 2020 a marqué l'avènement d'un temps nouveau, empreint d'une violence que nous croyions réservée aux films noirs. Une réalité pourtant familière aux employés du port qui, depuis déjà plusieurs années, vivent dans la peur qu’on les file jusque chez eux pour leur extorquer leur badge d’accès aux périmètres sécurisés des docks.
Si la cocaïne fait désormais régner la terreur sur les grands ports de toute l’Europe du nord, Le Havre occupe une place tristement privilégiée. Car c’est le premier port où abordent les cargos en provenance d’Amérique latine et des Antilles. Et la dope avec eux. De quoi faire régner l’omerta. Les autorités ont refusé que les scènes portuaires de De grâce soient tournées au Havre et la mairie n’a pas souhaité que la ville accueille l’avant-première de la série. La dame blanche fait trembler sur les quais, mais aussi dans les cabinets des politiques se voyant bien à l’Elysée.
La poudre se fout de l’Etat de droit et des principes. C’est une nihiliste, qui achète ce qu’elle veut et possède une armée où se mêlent chiens de la casse comme pourris en col blanc. Elle ne veut le pouvoir que pour exercer son business. Sa logique est celle d’un capitalisme appliqué au pied de la lettre, qui offre un produit générant des marges colossales et une addiction terrifiante chez ses consommateurs. Un blockbuster.
Aujourd’hui, la drogue est l’une des principales menaces pour nos démocraties. Le modèle du tout-répressif est impuissant. Des voix toujours plus nombreuses s’élèvent pour cibler en priorité les avoirs issus du narcotrafic. Mais voilà, c’est un travail de longue haleine, qui ne donne pas de reportages spectaculaires, nécessite une collaboration suivie entre polices du monde entier et une réflexion globale au sujet de notre système financier et fiscal. La drogue entraîne et se nourrit de la violence de ce monde mené par la fétichisation des images choc, du court-termisme et du fric. Autant dire que le royaume de cette courtisane qui ne respecte qu’elle-même a encore de beaux jours devant lui.
Le petit-déjeuner des champions, Kurt Vonnegut
Je viens de finir ce roman de Vonnegut, lu pour l’écriture d’un nouveau livre, où l’humour doit permettre à mon héros de supporter l’insoutenable. J’ai rarement lu des choses si profondes et acerbes sur la mission de l’écrivain, si jamais il y en a une, et sur la rivalité entre réalité et fiction.
Voici un passage qui m’a particulièrement marqué :
A l’approche de mon cinquantième anniversaire, j’avais été de plus en plus furieux et perplexe face aux décisions idiotes que prenaient mes concitoyens. Et puis j’avais soudain fini par les prendre en pitié, car j’avais compris avec quelle innocence et quel naturel ils se conduisaient de manière si abominable, avec des conséquences si abominables : ils faisaient de leur mieux pour vivre comme les personnages qu’on rencontrait dans les histoires.
“J’avais compris avec quelle innocence et quel naturel ils se conduisaient de manière si abominable, avec des conséquences si abominables : ils faisaient de leur mieux pour vivre comme les personnages qu’on rencontrait dans les histoires. ”
Voilà pourquoi les Américains se tiraient si souvent dessus : c’était un procédé littéraire pratique pour terminer une nouvelle ou un livre (…) Quand je compris ce qui faisait de l’Amérique une nation si dangereuse et malheureuse d’individus qui n’avaient plus aucun rapport avec la réalité, je pris la décision de tourner le dos aux histoires. J’écrirais sur la vie. Chaque personnage aurait strictement la même importance que n’importe quel autre. Tous les faits pèseraient aussi le même poids. Rien ne serait laissé de côté. Aux autres d’apporter de l’ordre au chaos. Moi, j’apporterais du chaos à l’ordre, comme je crois y être parvenu.
Si tous les écrivains faisaient de même, alors peut-être les citoyens en dehors des cercles littéraires comprendraient-ils que l’ordre n’existe pas dans le monde qui nous entoure, qu’il nous faut au contraire nous adapter aux conditions du chaos.
“Si tous les écrivains faisaient de même, alors peut-être les citoyens en dehors des cercles littéraires comprendraient-ils que l’ordre n’existe pas dans le monde qui nous entoure, qu’il nous faut au contraire nous adapter aux conditions du chaos.”
C’est difficile de s’adapter au chaos, mais c’est possible. J’en suis la preuve vivante : c’est possible.
"Il n'y a pas plusieurs arts", Ravel
A la suite de la remarquable biographie de Ravel par Jankélévitch, vient un texte où Ravel raconte ses “souvenirs d’enfant paresseux”. Il ramasse ainsi l’intuition qui m’a mené à écrire sur la peinture et Un coup de pied dans la poussière puis à me lancer dans mon prochain roman, qui traite de musique.
“Pour moi, il n’y a pas plusieurs arts, mais un seul.
Musique, peinture et littérature ne diffèrent qu’en tant que moyens d’expression. Il n’y a donc pas diverses sortes d’artistes, mais simplement diverses sortes de spécialistes.
Cette spécialisation devient de plus en plus obligatoire au fur et à mesure que les connaissances s’accroissent; car rien, même en art, ne peut s’acquérir sans études.”
David Chase
“Oubliez toutes ces conneries à propos des rooms d’écriture, etc. La seule chose qui importe, c’est la liberté créative. ”
“Ma mère était complètement tarée.”
“Sans HBO, je me serais noyé.”
Souvenirs d’une rencontre avec David Chase, où le créateur de la série “Les Soprano” s’exprimait sur sa vision du métier. Un vrai sacerdoce, un travail énorme, avec ce qu’il faut d’organisation, d’improvisation, de lâcher prise et de vision. Il confiait aussi à quel point les personnages de série-phare étaient inspirés de ses proches. Notamment la mère de Tony.
Les lauriers sont coupés, Dulaurier
Quelques heures dans la vie d’un jeune homme, employé de bureau, dont la famille est provinciale. Six heures, je crois. Une belle soirée de printemps. Avril, les grands boulevards. Il est seul, personne ne l’attend. Il songe à se rendre chez sa maîtresse en fin de soirée. Une actrice qu’il entretient et avec laquelle il voudrait coucher. Le seul suspense du livre.
L’odeur des bouillons, les regards dans la rue, les espoirs d'avancement et le vertige à demi avoué d'être à une certaine place de l'éternité, vivant, sans savoir pourquoi ni au nom de quoi.
Le premier roman du monologue intérieur, sauvé de l’oubli grâce à Joyce qui encourage Larbaud à la lire en 1920. Dujardin a inspiré son Ulysse. Un court roman sur l’étourdissement constamment renouvelé d’être au monde.
Dans ma bibliothèque avec la librairie "Des gens qui lisent"
Un beau moment pour un podcast dans lequel je plonge dans ma bibliothèque en compagnie de Dolly, de la librairie “Des gens qui lisent” à Sartrouville, à l'occasion de la publication de Un coup de pied dans la poussière.
Mais c'est encore Dolly qui parle le mieux de cette rencontre et de mon livre : Ceci est une rencontre suspendue. Au-dessus du bruit du monde, dans une ruche d'artistes, j'ai fait la connaissance d'un garçon encore plus enthousiaste que moi quand il s'agit de parler de livres (et il faut y aller). Quand j'ai lu le roman de Baptiste Fillon, Un coup de pied dans la poussière, en janvier dernier, j'ai été embarquée par son écriture romanesque, par l'attention et l'amour qu'il porte à son personnage principal, Nissan Rilov, peintre du 20ème siècle pacifiste et humaniste. Il m'a proposé de le rejoindre à La Ruche, un atelier d'artistes du 14ème arrondissement dans lequel a vécu et travaillé le personnage de son livre. C'était magique de parler de littérature dans cet endroit, peuplé de tant d'autres vies, de tellement d'histoires. C'était magique de s'échapper soudain dans un roman, dans un personnage, et de retrouver le sens qui manque si souvent à nos vies.
“Quand j’ai lu le roman de Baptiste Fillon, Un coup de pied dans la poussière, en janvier dernier, j’ai été embarquée par son écriture romanesque, par l’attention et l’amour qu’il porte à son personnage principal, Nissan Rilov,”
Parfois, quand on aime les mêmes livres, on se surprend à se reconnaître alors même qu'on se parle pour la première fois. La rencontre avec Baptiste avait ce parfum là, spontané, amical, naturel. Il y a eu des éclats de rires et des confidences, des histoires de marins au loin sur l'océan, des havres de paix et des questionnements intérieurs. Il y a eu des histoires qui nous cueillent et nous déplacent, nous emmènent là où on n'aurait pas imaginé. Il y a eu des clins d'oeil à Flaubert, Amado, Pessoa ou encore Rimbaud, et tous étaient là autour de nous dans cette conversation qui aurait pu ne jamais s'arrêter.
“Il y a eu des éclats de rires et des confidences, des histoires de marins au loin sur l’océan, des havres de paix et des questionnements intérieurs. Il y a eu des histoires qui nous cueillent et nous déplacent, nous emmènent là où on n’aurait pas imaginé. Il y a eu des clins d’oeil à Flaubert, Amado, Pessoa ou encore Rimbaud, et tous étaient là autour de nous dans cette conversation qui aurait pu ne jamais s’arrêter.”
Ce podcast est à écouter au-dessus des nuages, le regard perdu dans le ciel, vue sur la Tour Eiffel, caché dans la chambre de ses enfants ou au fond d'une librairie de bord de mer. On y entre sans savoir ce qu'on y cherche, et c'est un peu de soi-même que l'on trouve.
Merci Baptiste pour ta confiance.
Belle journée dans les livres
Le narcotrafic dans "De grâce" sur France Info radio
Le 23 janvier dernier, j’étais l’invité de Frédéric Carbonne durant son émission “Tout public”, pour m’exprimer au sujet du trafic de drogue dans la série De grâce, ainsi qu’à propos des gens du port et de leur fierté de corps. Extrait :
“On se rend compte que la drogue et sa puissance financière sont en train de tout nécroser, et ça à toutes les échelles.”
Intégralité de l’interview disponible ci-dessous :
Lima, la ville entre trois infinis
Lima est à la rencontre de trois infinis, dit-on : l'océan, le désert et les Andes. Dans Moby Dick, Melville fait dire à l’un de ses personnages qu'il s'agit de la ville la plus étrange et la triste au monde. Je ne la connais qu'en hiver, où son ciel est d'un gris blanc et s'émiette en faisant une bruine grumeleuse, qui crépite doucement sur votre visage : la garúa. En début d'après-midi, au pic de la luminosité du jour, le ciel est pris d'une clarté irréelle, une pâleur de lampe chirurgicale. A force, on oublie la possibilité du soleil.
“The strangest, saddest city thou can’st see.”
Elle abrite le bordel immense d'une ville sud-américaine, congestionnée à mort, où des vies entières se passent en voiture, à se ravitailler aux vendeurs de nourriture des feux rouges. En taxi, on traverse des mondes, depuis les immeubles miséreux en briques nues de Callao jusqu’aux bâtisses chics de San Isidro ou Miraflores. Là, on arrive au bout de l’univers, aux falaises noires d'où on voit les vagues plisser le gris Pacifique comme une pièce de métal repoussé. Au sud, un immense crucifix lumineux sur un piton rocheux.
Les fenêtres situées à l’arrière du palais présidentiel donnent sur le quartier de Rímac et la rivière du même nom, qui pue l'ordure, enjambée par un pont où passe l'héroïne de la chanson de Chabuca Granda, "La flor de la canela". Un quartier de maisons coloniales croulantes, entre lesquelles bruissent un marché de breloques et les cris de vendeurs de nourriture de rue. Le coin est dangereux. Un policier militaire équipé d'un fusil automatique monte la garde. C'est comme si le palais de l'Elysée plongeait sur les pires endroits de La Courneuve ou de Bagneux. Derrière Rímac, une montagne aux pentes occupées par le bidonville de San Cristobal, surmontée d’un grande croix. Encore une.
Lima est fendue par une autoroute intérieure, où croisent des SUV, des voitures déglinguées et des carrioles tirées par des motos. C’est une large saignée surmontée d'immenses panneaux publicitaires où défilent les plus beaux rêves consuméristes. Là, les arrêts de bus ressemblent à des capsules spatiales larguées au milieu de la circulation chaotique. Un homme observe le trafic, accoudé au rail de sécurité en béton. Couché sur un talus, un autre se gratte frénétiquement la tête.
Dans le centre historique, le calme se trouve dans la paix bétonnée des églises du quartier, surtout de la Merced, peinte d’orange et de jaune tendres, devant ses grandes chapelles où s'élèvent de hauts autels de bois sombre, dans lesquels trônent des vierges.
Lima est porteuse d’une mélancolie bizarre et frénétique. Malgré l’inflation, l’incurie politique et la violence, elle vit, dans l’attente du prochain tremblement de terre, portée par une mélancolie vivace, bien jeune et vivante, qui diffère de la tristesse et de la nostalgie.
Tous ceux qui tombent, Jérémie Foa
Le massacre de la Saint-Barthélemy (détail), François Dubois (1529-1584), Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne.
Fin août 1572 en France. Les catholiques massacrent les huguenots. C’est le temps de la proverbiale nuit de la Saint-Barthélémy à Paris. Mais il n’y a pas seulement Paris et pas seulement cette nuit-là. Jérémie Foa y revient avec acharnement et ténacité dans un livre au ras du sol, au ras des gens, dans la lignée de la micro-histoire de Ginzburg. Il s’inscrit au plus proche des états d’âme des oubliés d’un massacre qui s’inscrit en lettre de sang dans l’histoire de France. On tue par fanatisme, les enfants comme les vieillards, partout dans le pays, on tue par intérêt, pour récupérer un héritage, la maison du voisin, se débarrasser d’une épouse ou d’un mari encombrant. Les assassins deviennent des notables, adoubés par Henri III, qui meurent dans la paix douillette de leur lit. Il faut saluer le style, l’extrême rigueur et la passion avec lesquels travaille Jérémie Foa, qui refait entendre les cris des massacrés et des assassins, ainsi qu’un fondamental besoin de justice face à la brutalité avec laquelle certaines victimes furent suppliciées puis oubliées.
“Interminable appel des morts. Noms de papier qui précipitèrent le destin des victimes, valant droit de vie ou condamnation. Ces listes ont été patiemment collectées au prix d’heures d’enquêtes, de délations, mais surtout au gré d’interactions d’homme à homme et de contacts visuels (...) La Saint Barthélémy est l’opposé d’un massacre mercenaire (...) Le massacre existe dans le corps des bourreaux avant d’exister au dehors. On l’a déjà souligné, avant d’êtres accomplis en vrai, les gestes du pogrom ont été peaufinés par les bourreaux lors des innombrables arrestations des années 1568-1570.”
L'île d'Arturo, Elsa Morante
C’est le roman de Procida, que je m’étais juré d’emporter le jour où je visiterais l’île. Voici dix ans qu’on me l’a offert. J’ai séjourné sur l’île cet été. Procida a bien changé depuis l’époque d’Arturo. C’était voici moins d’un siècle, peu avant une première guerre mondiale qui clôt le roman et fait retomber Procida dans l’Histoire. Car l’île du roman est drapée dans une éternité propre aux pays archaïques, où les gens vivent pieds nus et sans électricité alors qu’ils ne se trouvent qu’à trente minutes en bateau de Naples.
“A présent, à l’idée de mourir, de quitter cette vie et cette belle petite île de Procida, où j’ai connu toutes les insouciances et tous les bonheurs, je me console avec un espoir : il y en a qui croient que les morts sont des esprits et qu’ils voient tout : peut-être est-ce vrai ?”
C’est un magnifique livre d’été, le mythe d’un petit garçon qui devient un homme, avec ses plaisirs faciles de romans de grand air et d’appel de vie, de soleil infini, mais aussi de révélations crues : la lâcheté d’un père, le désamour des femmes, la bestialité du sexe. Il dépeint la solitude enchantée d’un gamin livré à lui-même, sur une île hors de l’univers.
J’ai lu ce roman avec grand appétit, malgré quelques poussées de sentimentalisme et des montées d’émotion un peu trop soulignées. L’île d’Arturo restitue la joie immensément solaire des après-midis d’enfance où tout semble possible. Il est plein d’une joie d’être au monde qu’on retrouve en se promenant entre les maisons colorées de Procida, aux murs arrondis et polis, presque troglodytes, sous le cagnard de quinze heures et sur le pavage de pierres noires qui vous chauffent les pieds à travers les semelles, juste avant plonger dans l’eau bleue.
Les braises, Sándor Márai
Un roman lu et acheté au moment de mon voyage à Budapest, d'un écrivain interdit en Hongrie jusqu’en 1990, pour nourrir le goût du disparu, de cette bringuebalante chimère qu'était l'empire austro-hongrois, ce pays éteint, aux bâtiments en bonbonnière jaunes, oranges, aux aristocrates aux noms imprononçables.
Un extrême classicisme, une structure en bloc clairement ventilés et les passions survivantes d’un monde croulant, qui éclairent celui qui s’annonce poussivement. C’est le portrait d’une époque crépusculaire, où les puissances ont changé de dynasties et le pouvoir d’épaules. Ce roman fait aussi le récit d'une amitié transformée en duel d’amour, un triangle entre deux prétendants et une morte, où chacun détruit et trompe.
“Il ne faisait pas encore bien clair. C’était le moment où la nuit cède la place au jour, moment où se décident bien des choses sur terre.”
L'Euro des écrivains à Berlin
De longues balades matinales dans le nord de Berlin, sur des boulevards aux apparences de nationales en pleine ville, qui se terminent en ruelles perpendiculaires sur des parcs en ruine. Même si elle vend bien son image de friche déglinguée, les toilettes des bars underground sont taggés mais bien briqués. C’est une punkette qui se lave, se parfum, picole un peu et mange bio.
Berlin est une attachante géante, où cela marche sans se bousculer, s’habille sans s’endimancher, où l’herbe des parcs est autorisée, où les gens ne lèvent pas les yeux au ciel quand vous entrez dans un restaurant avec des enfants et où la vie reste assez abordable.
Un tournoi de football qui rassemblait aussi l’Italie, la Pologne, l’Allemagne, l’Espagne, la Suède, l’Angleterre et l’Autriche, dont nous sommes demi-finalistes et finissons quatrièmes, au début d’un été presque inespéré.
Avec Jean-Baptiste Guinchard et Claude Boli.
En vol
“Nous vivons sur les nuages, dans des plaines très blanches toutes nappées de jaune dur, sous le bleu éternellement, dégradé de l’azur noir de l’espace. On ne nous pas encore trouvés car on ne nous cherche pas. Voici très longtemps, ceux d’en bas nous confondaient avec leurs morts.”