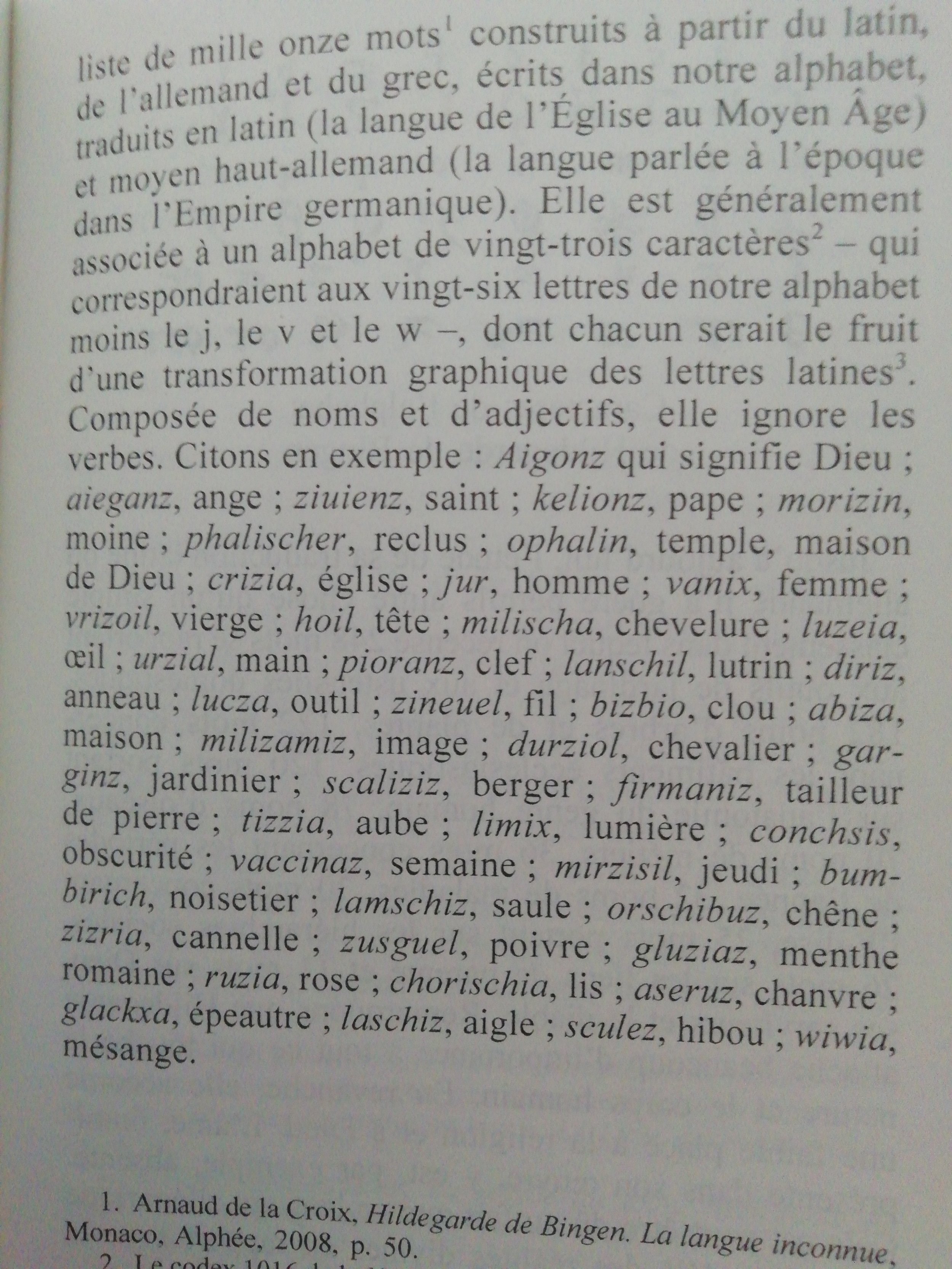Le livre fut écrit pour elle, en son nom de chef-d'oeuvre, degré zéro de la conscience de soi. Rapidement, Dino s'éprend de cette chair sans âme ni volition. Cécilia est un objet sexuel impossible à posséder, jouissant d'une liberté d'insecte, indifférente à son propre sort comme à celui des autres, naviguant instant après instant.
Elle se pose en reflet des pulsions des hommes qui la couvrent. Elle est une chose parfaite, éternellement séduisante. Dino attente à à ses jour dans l'espoir de remédier à son addiction pour elle, perversité qui minaude, miroir de l'égo des mâles, amoureuse qui jamais ne lasse.
Cette jeune fille forme un ennui qui dissout les scrupules, les faux-semblants de l'amour, la tendresse. Elle joue sa rébellion dans l'inconstance, la servitude, l'inconsistance des réponses puériles qu'elle fait à l'indignation de Dino. Elle instaure un questionnement infini du monde, le dissèque à l'aide de tautologies, de nullités qui sapent ses fondements.
Cécilia se veut de ces objets d'art moderne, dont la platitude s'emplit du discours que le spectateur, l'artiste ou le promoteur d'exposition prononcent à son sujet. Elle est un support, l'urinoir de Duchamp ou le monochrome de Kandinsky.
Sa nullité convient à l'ultime degré de cynisme comme au premier seuil de l'abrutissement.