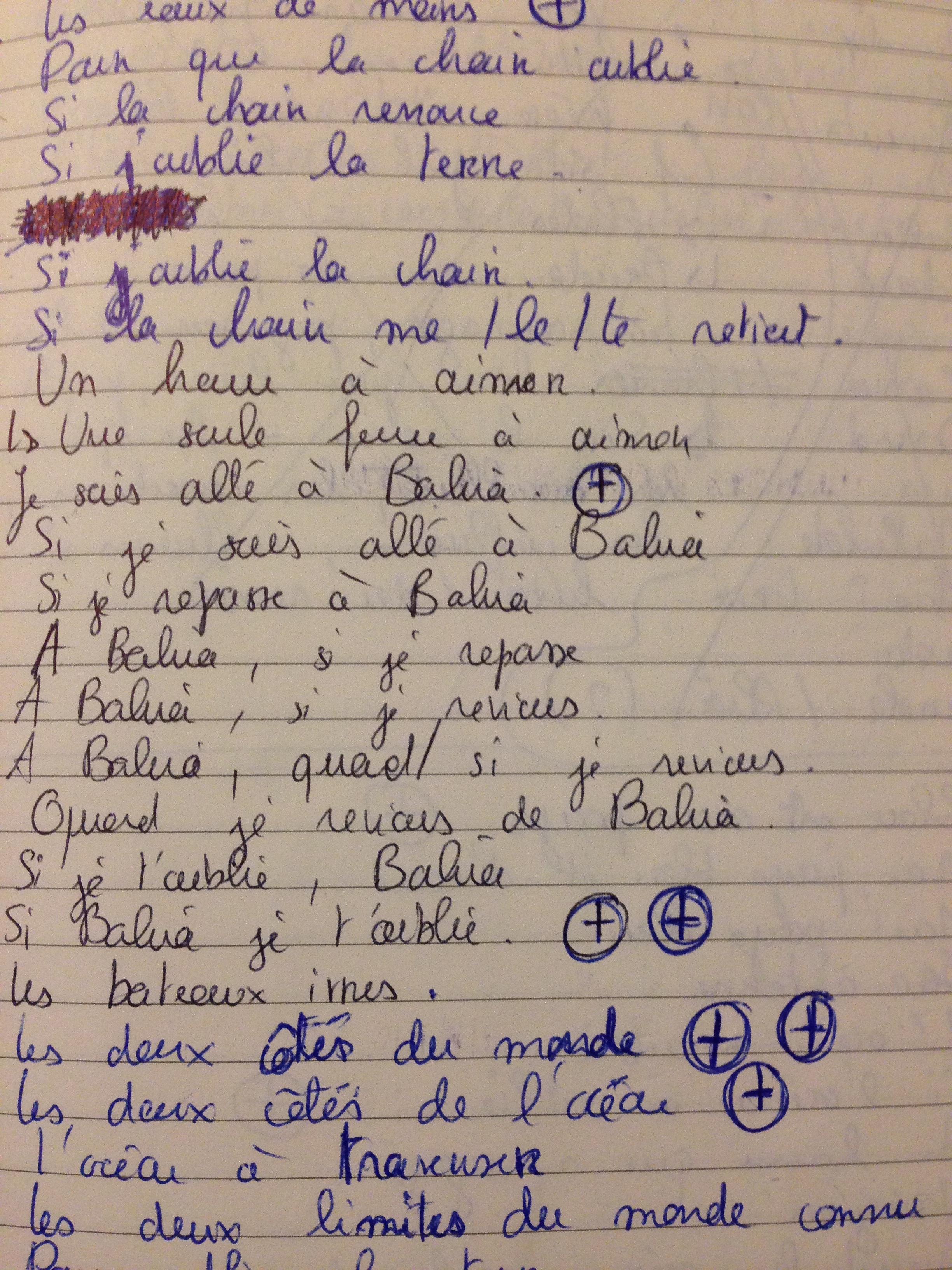Gustav Klimt, ou le rêve en sécession
Klimt est la preuve que les immenses artistes échappent à leur époque, et aux mots de leurs exégètes, comme ceux que j’écris là.
Tout commentaire s’avère redite appauvrie de ses peintures. Chacune de ses oeuvres déclare une vérité qui n’est exprimable que par elle. Le reste n’en est qu’une périphrase indigente.
Panneau de la frise Beethoven (1902)
Je peine à comprendre pourquoi, tel homme, voici plus d’un siècle, s’est mis à peindre ainsi, en dépit de ce que les historiens de l’art évoquent sur cet Empire austro-hongrois insensé, où personne ne s’entendait, engoncé dans un décorum creux, sous une pyramide de grabataires et un académisme mort, attentifs à leur seule conservation.
L’or est toujours là, dans la lumière, ou étalé sur l’œuvre elle-même, flottant comme la poudre du rêve. Les personnages ont cette allure raide et alanguie, comme des statues ou des bijoux, où se trahit le fils d’orfèvre qu'est Klimt. Il a cette extrême précision des songes, vaporeuse et définie, primitive et sophistiquée, dans un relâchement étudié, extrêmement agencé, comme sa Judith ou sa Salomé, où se dévoile l’inquiétude neuve de la femme puissante, naturelle dans le vice.
Judith et Holopherne (1901)
En 1892, la mort de son frère l’incite à rompre avec l’académisme, cette tragédie intime lui rappelant la nécessité d'assumer sa vocation d'artiste. De découvreur.
Klimt incarne la réussite ultime d’une coalition composée du Flaubert de La tentation de Saint-Antoine, Doré, Moreau et Beardsley.
La Philosophie (1900, détruite en 1945 par les nazis)
Il est l’un des modernes à comprendre le mieux que tout est allégorie. Il ruine la parodie à laquelle les académiques confinent la peinture.
Une grande chance que l’exposition de la Pinacothèque montre aussi les travaux de Schiele et de Kokoschka, plus sanguins, bouchers, instaurant une forme de déstructuration charnelle de l’âme humaine au temps des massacres de masse, ou de leur annonce.
"Au temps de Klimt, la Sécession à Vienne", Pinacothèque de Paris, du 12 février au 21 juin 2015.